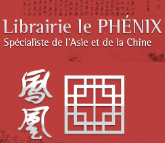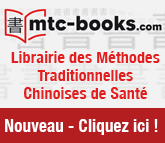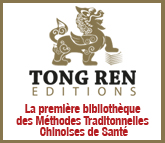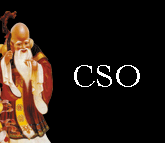L’effet placebo a été largement étudié dans la littérature ces dernières années. On sait notamment que le contexte, les attentes et le conditionnement (expériences antérieures) influencent massivement cet effet.
Effet nocebo : aggravation de la pathologie douloureuse et/ou apparition d’effets secondaires du médicament prescrit.
Cette étude a tenté d’appréhender les modalités d’une information nocebo chez des volontaires sains soumis à des stimulations douloureuses expérimentales.
L’objectif était de savoir si cette information nocebo pouvait s’opposer à l’antalgie obtenue par une pommade antalgique.
Le second objectif était de savoir si cet effet nocebo était médié par des émotions négatives.
Cent-quarante-deux volontaires sains (73 femmes) ont été randomisés en 6 groupes.
La crème EMLA et la crème placebo ont été administrées en accompagnement de différentes suggestions :
- suggestion d’effet antalgique et
- suggestion d’hyperalgésie (soit 4 groupes).
- Le 5ème groupe a reçu de l’Emla sans suggestion et
- le 6ème groupe aucun traitement.
L’expérience a consisté à appliquer une stimulation thermique (48°C) pendant 1 prétest et 2 posttests.
La douleur a été évaluée pendant la stimulation, ainsi que le stress et la TA (tension artérielle) avant le prétest, après l’application de la crème, et après le posttest.
Les résultats ont montré que :
- la douleur était moins intense de façon significative dans le groupe recevant l’Emla et des informations positives.
- La douleur était plus intense dans les groupes recevant des suggestions d’hyperalgésie quel que ce soit le produit appliqué ; Emla ou placebo.
Les analyses sur la TA et le stress ont montré que ces paramètres pouvaient être des médiateurs de l’hyperalgésie après suggestion nocebo.
L’information nocebo pouvait donc renverser l’analgésie topique provoquée par la pommade Emla chez des volontaires sains.
Commentaires
Ces résultats sont intéressants car cette méthodologie complexe permet d’interpréter réellement les testsvia des analyses :
- avant et après stimulation,
- avec et sans molécule active,
- avec et sans suggestion dans les 6 groupes.
En effet, on connaît de mieux en mieux les mécanismes induisant l’effet placebo notamment les voies endorphiniques et dopaminergiques.
On sait que l’effet nocebo n’est pas l’opposé de l’effet placebo car il passe par des voies différentes : l’effet nocebo serait favorisé par l’anxiété via les CCK (cholécystokinines).
De plus, ces résultats confirment l’importance de l’information donnée lors de toute prescription.
Même si on ne peut pas « guérir » la douleur chronique, on peut optimiser les prescriptions :
« La consultation devrait inclure une information précise sur la maladie, et son traitement mais qui doit être délivrée d’une manière positive et favorable qui évite le nihilisme et un pessimisme excessif »
(Comprendre l’effet placebo en rhumatologie. Abhishek A, Rev Rhumatisme 2015 ; 82 : 211-213).
Un patient moins anxieux aura donc :
- toutes les chances d’éviter l’effet nocebo (aggravation de la pathologie douloureuse et/ou apparition d’effets secondaires du médicament prescrit)
- et prétendre à la meilleure efficacité possible.
On pourrait résumer cela en disant que : « l’anxiété n’est pas bonne conseillère ».
Date de publication : 27 Jan. 2016
Nous contacter :


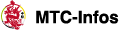





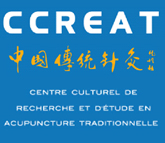





 Effets opposés de l’application d’un antalgique topique via des informations nocebo chez le volontaire sain exposé à une douleur expérimentale : antalgie versus hyperalgésie
Françoise Laroche
Par le Pr Françoise Laroche (CETD, Hôpital Saint-Antoine - Paris)
Article commenté :
Opposite effects of the same drug: reversal of topical analgesia by nocebo information.
Aslaksen PM, Zwarg ML, Eilertsen HI et al.
Pain. 2015 ; 156(1):39-46
Effets opposés de l’application d’un antalgique topique via des informations nocebo chez le volontaire sain exposé à une douleur expérimentale : antalgie versus hyperalgésie
Françoise Laroche
Par le Pr Françoise Laroche (CETD, Hôpital Saint-Antoine - Paris)
Article commenté :
Opposite effects of the same drug: reversal of topical analgesia by nocebo information.
Aslaksen PM, Zwarg ML, Eilertsen HI et al.
Pain. 2015 ; 156(1):39-46