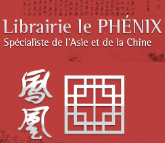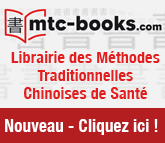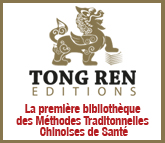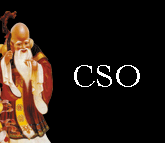Cette étude espagnole, publiée dans l’édition en ligne du 27 avril 2011 de la revue Heart de l’American Heart Association démontre l’association entre rythmes circadiens et “cardioprotection”.
Cette étude menée sur plus de 800 patients ayant subi une crise cardiaque, a examiné l'association possible entre l’horaire de la crise et les niveaux de deux enzymes dans le sang marqueurs de dommages sur les tissus du coeur sachant que des niveaux plus élevés indiquent de plus grandes “zones de dégâts”.
Cette étude vient compléter les connaissances actuelles sur les rythmes circadiens et le risque cardiaque. Menée par des chercheurs de l'Hospital Clinico San Carlos et le Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (Madrid) cette analyse transversale, sur de 811 patients atteints, a souhaité déterminer si l'heure de la journée affecte la gravité des dommages causés par l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Ce type de crise cardiaque se produit lorsque l’artère coronaire est totalement obstruée par un caillot et la circulation sanguine interrompue, ce qui endommage toute l’épaisseur du muscle cardiaque alimenté par l’artère.
Les niveaux de créatine kinase (CK) et de troponine I (TnI) ont été mesurés à l'admission, puis toutes les quatre heures. Ces deux enzymes sont les marqueurs chimiques retenus pour évaluer les dommages aux tissus cardiaques. En divisant l'horloge de 24 heures en quatre périodes d'égale durée, en phase avec les rythmes circadiens, les chercheurs aboutissent à une «variation circadienne" dans la mesure des dommages causés aux tissus cardiaques, tels que mesurés par les 2 marqueurs.
Les dommages représentés par les niveaux des 2 marqueurs atteignent un maximum chez les patients ayant subi une crise cardiaque dans la période de 6 heures du matin à midi, et respectivement plus élevés de 18,3% et 24,6% pour CK et TnI. Les chercheurs suggèrent que l'évolution naturelle de l'organisme au cours d’un cycle de 24 heures est telle qu’à certains moments de la journée, la «cardioprotection» est plus faible.
Les variations circadiennes de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et du débit coronaire pourraient toutes être impliquées.
HORLOGE BIOLOGIQUE: Passer à l’heure d’été
American College of Cardiology
Le passage à l’heure d'été accélère l’incidence des événements cardiaques, et surtout durant le lundi qui suit, constate cette étude de l’Université de Colorado de Denver.
notre horloge n’aime pas être décalée.
Conséquence d’une horloge biologique décalée et d’une heure de sommeil en moins, cette augmentation estimée à 25% de l’incidence des crises cardiaques le lundi qui suit le changement d’horaire, pèse en faveur de l’abandon d’un changement d’heure, dont les effets en matière d’économie d’énergie ne sont plus démontrés.
C’est l'étude la plus large menée sur les données d’incidence des événements cardiaques intervenus le lundi suivant l’heure d’été –où on avance d’1 heure- en comparaison des autres lundis de l'année. Les chercheurs ont analysé les données concernant 42.060 admissions à l'hôpital sur 1.354 jours, ont identifié les admissions pour crise cardiaque et ajusté ces données en fonction des variations saisonnières et du jour de la semaine.
L’analyse constate une augmentation de 25%, qui reste significative même après prise en compte des variations saisonnières de ces événements.
En revanche, le total de crises cardiaques constatées sur l’ensemble de la semaine suivant le passage à l’heure d’été n’est pas significativement modifié par rapport à d’autres semaines de l’année. Cela suggère qu’avancer d’une heure va précipiter l’occurrence des crises cardiaques dans les heures qui suivent, chez des patients à risque élevé. Le Dr Amneet Sandhu, cardiologie à l’Université du Colorado et auteur principal de l'étude confirme que le changement d’heure affecte principalement les personnes déjà vulnérables sur le plan cardiaque.
Une augmentation concentrée le lundi :
Lorsque les chercheurs comparent les admissions d’hôpitaux du Michigan le lundi précédant l'heure d'été et le lundi suivant immédiatement l’heure d’été sur 4 années consécutives, ils constatent même une augmentation de 34% des crises cardiaques d'une semaine à l'autre. Ils évoquent plusieurs facteurs pouvant expliquer cette concentration du lundi, autres que d’être simplement le jour qui suit le changement d’heure. Les auteurs évoquent le stress et le changement de durée de sommeil liés à une nouvelle semaine de travail qui commence.
Et que se passe-t-il si l’on revient à l’heure normale ?
L'étude montre alors l'effet inverse, soit une baisse de 21% du nombre de crises cardiaques le mardi qui suit le retour à l'heure normale à l'automne. Bref, notre horloge n’aime pas être décalée. Ces données interviennent alors que certains experts remettent aujourd’hui en question l’intérêt de l’heure d’été en raison du doute sur les économies d’énergie qu’elle permet et de ses effets négatifs sur la santé. (Le Ministère de l’Energie estime à 440 GWh, l’économie en éclairage réalisée en 2009 grâce au changement d’heure soit la consommation d’environ 800.000 ménages).
L’INFARCTUS guette les cœurs blessés par le décès d’un proche
Actualité publiée le 10-01-2012
CIRCULATION
Le risque de crise cardiaque augmente de manière significative dans les jours qui suivent le décès d’un proche, selon cette étude, menée sur près de 2.000 victimes de crise cardiaque et financée par les National Institutes of Health (NIH) et publiée dans l’édition en ligne du 9 janvier de Circulation, l’une des revues de l’American Heart Association. C’est la toute première étude à mesurer les conséquences cardiaques du décès d’un proche.
Cette étude menée sur 1.985 victimes de crise cardiaque entre 1989 et 1994, a interrogé les patients sur les circonstances entourant leur crise cardiaque et sur la perte éventuelle d’un être cher au cours de l’année précédente et, sur la qualité de leur relation.
L’étude conclut, à la suite du décès d’une personne aimée, à un risque 21 fois plus élevé que la normale d’infarctus dans la première journée qui suit le décès du proche, 6 fois plus élevé durant la première semaine. Ce risque revient « à la normale » progressivement au cours du mois qui suit. Enfin, le risque varie en fonction de la gravité de la crise, de 1/320 personnes pour une crise légère à 1/1.394 pour une crise cardiaque grave. C’est une conclusion importante pour la prévention de ce risque, par les professionnels de santé, au cours des consultations de personnes touchées récemment par ces décès, expliquele Dr. Murray Mittleman, cardiologue à la Harvard Medical School, au Beth Israel Deaconess Medical Center et à l’Ecole de santé publique de Boston.
Le stress psychologique augmente le rythme cardiaque, la pression sanguine et la coagulation du sang, ce qui renforce le risque d'attaque cardiaque. Par ailleurs, au début du processus de deuil, la qualité de sommeil est dégradée, tout comme l'appétit et les niveaux de cortisol sont plus élevés, ce qui peut également augmenter le risque. Enfin, les raitements pharmacologiques peuvent être négligés.
Quand le décès rime avec solitude : les conséquences cardiaques sont encore plus graves lorsqu’il s’agit de la perte d’un conjoint, les décès « cardiaques » de conjoints seuls représentant jusqu’à 53% des décès.
Conclusion, non seulement les professionnels de santé doivent être conscients de cette augmentation du risque cardiaque à la suite d’un deuil, mais amis et famille des personnes endeuillées doivent aussi apporter un soutien rapproché pour contribuer à prévenir de tels événements. Les patients devraient également consulter, après le deuil d’un Aimé : «Au cours des situations de douleur extrême et de détresse psychologique, les patients doivent consulter un médecin pour tout symptôme associé à un incident cardiaque», conclut le Dr. Mittleman.
INFARCTUS: 2 boissons alcoolisées par jour limitent de 40% le risque de décès
European Heart Journal
Les buveurs modérés survivent mieux à la crise cardiaque, selon cette étude menée sur plus de 1.800 hommes suivis durant 20 ans, par des chercheurs de la Harvard Medical School.
Ces conclusions publiées dans l’European Heart Journal précise la consommation d’alcool associée à cette réduction de 42% du risque de décès, soit 10 à 30 g d’alcool par jour.
De précédentes études ont montré qu’une consommation modérée d’alcool pouvait être associée à un risque cardiaque moindre. Ici, l’étude a porté sur les données de 1.800 hommes, professionnels de santé qui ont subi une première crise cardiaque durant le suivi d’une étude de cohorte, la Health Professionals Follow-up Study (HPFS), menée sur 20 ans.
Le fait que les participants soient des professionnels de santé implique que leur comportement en matière de santé peut différer de celui de la population générale. Les chercheurs de la Harvard Medical School et d’autres institutions américaines ont mesuré la consommation d'alcool et autres habitudes alimentaires au départ de l’étude puis tous les 4 ans.
La consommation d'alcool déclarée a été convertie en grammes d'alcool pur consommés chaque jour :
- 1 bière = 12,8 g d'alcool, un verre de vin = 11.0 g, une vodka = 14g)
- 0,1 à 9.9g= environ 1 verre, de 10 à 29.9 g= environ 2 verres et ≥ 30g = environ trois verres,
puis les chercheurs ont examiné la relation entre la consommation d'alcool de long terme et le risque de décès chez les hommes qui avaient survécu à leur première crise cardiaque.
Les auteurs ont ajusté les données avec les facteurs confondants comme l'âge, l'indice de masse corporelle (IMC), l'état matrimonial, le statut tabagique, l’activité physique, l'apport calorique total, l'utilisation des médicaments, des antécédents de diabète et d'hypertension artérielle et les antécédents familiaux d'infarctus.
Entre 10 et 29,9 g d’alcool par jour, la réduction du risque est la plus élevée :
Au cours de l'étude, les participants qui consommaient en moyenne entre 10 et 29.9g d'alcool par jour (soit environ 2 boissons alcoolisées) avant et après leur crise cardiaque, ont présenté un risque réduit de décès toutes causes confondues ou de décès cardiovasculaire par rapport aux participants non consommateurs d’alcool :
· le risque de décès toutes causes confondues
- Un risque de décès toutes causes confondues réduit de 22% chez les hommes qui ont consommé en moyenne 0,1 à 9.9 g d'alcool par jour (RR : 0,78, IC : 95% de 0,62 à 0,97) et de 34% chez les hommes qui ont consommé en moyenne 10 à 29.9 g quotidienne (HR : 0,66, IC : 95% de 0.51 à 0,86)
- pas significativement réduit chez les hommes qui ont consommé en moyenne 30g ou plus d'alcool par jour (HR : 0,87, IC : 95% de 0,61 à 1,25)
· le risque de décès cardio-vasculaire
- réduit de 42% chez les hommes qui ont consommé en moyenne 10 à 29.9 g d’alcool par jour (HR : 0,58, IC : 95% de 0,39 à 0,84)
- pas significativement réduit chez les hommes qui ont consommé en moyenne 0,1 à 9.9 g d'alcool par jour (HR : 0,74, IC : 95% de 0,54 à 1,02) ou qui ont consommé en moyenne 30g ou plus d'alcool par jour (HR : 0,98, IC : 95% de 0,60 à 1,60)
· La plupart des hommes n'ont pas modifié leur consommation d'alcool après leur crise cardiaque.
· Les hommes dont la consommation d'alcool augmente après une crise cardiaque a le même risque de décès que les non-buveurs.
· Les niveaux de consommation modérée d'alcool pris en compte dans l’étude sont largement dans les limites recommandées par les directives de Santé publique.
Les chercheurs concluent que chez les hommes qui ont survécu à leur première crise cardiaque, à long terme, une consommation d'alcool modérée est associée à une réduction du risque de décès, à la fois toutes causes confondues et de causes cardio-vasculaires.
Ils précisent aussi que ces résultats ne sont pas une raison de commencer à boire.
Une consommation modérée d’ALCOOL réduit de 40% le risque cardiaque
Cette large étude sur près de 150.000 personnes conclut qu’une consommation modérée d’alcool est associée à une diminution importante et jusqu’à 40% du risque de décès par maladie coronarienne.
Cette étude qui vient confirmer l’effet cardioprotecteur d’une consommation de quelques unités seulement par semaine, a été validée par le comité d’experts de l’International Scientific Forum on Alcohol Research. Des conclusions publiées dans la revue Circulation du 31 octobre, la revue de l’American Heart Association.
Cette étude qui a voulu tester l'hypothèse que la consommation modérée d'alcool exerce un effet cardioprotecteurprincipalement par une augmentation du taux sérique de cholestérol des lipoprotéines de haute densité, montre aussi que d'autres mécanismes que l'augmentation du cholestérol peuvent être impliqués dans cet effet bénéfique. Cette étude prospective, observationnelle, menée sur 149 729 Norvégiens, participant à la cohorte norvégienne Conor, recrutés de 1994 à 2003, a recueilli des données de consommation d'alcool par questionnaire et mesuré les niveaux de cholestérol HDL.
Un risque réduit de 40%:
Les chercheurs constatent que le ratio de risque (RR) ajusté de décès de maladie coronarienne
· pour les hommes consommant modérément de l’alcool plus d'une unité d’alcool par semaine, s’élève à 0,52 (IC : 95% de 0,39 à 0,69) vs les personnes n’en consommant jamais ou rarement.
· après ajustement avec le taux sérique de cholestérol HDL, les résultats évoluent peu : RR : 0,55 (IC : 95%, de 0,41 à 0,73)
· Pour les femmes consommant modérément de l’alcool plus d'une fois par semaine, les ratios de risque correspondants sont respectivement 0,62 (de 0,32 à 1.23) et 0.68 (0,34 à 1,34).
Comme le ratio de risque bouge peu après ajustement avec le taux sérique de cholestérol HDL, les chercheurs suggèrent que seule une faible partie de la réduction du risque de maladie coronarienne est liée à l’effet « augmentation du HDL » par la consommation d'alcool.
Les experts de l’International Scientific Forum on Alcohol Research ont examiné cette étude et, dans leur critique (1) estiment que c’est une analyse bien faite. Ils ont été surpris seulement par la faiblesse ou l'absence d'effet du cholestérol HDL. La plupart des études précédentes concluaient à un impact plus important de l’effet cholestérol HDL.
Nous contacter :


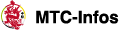





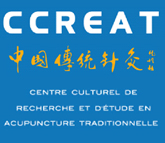





 Les INFARCTUS sont bien plus graves le matin
Les crises cardiaques sont beaucoup plus dangereuses le matin qu’à tout autre moment de la journée, car, en moyenne, elles entraînent des dommages dont le niveau de gravité sur le muscle cardiaque est de 20% plus élevé par rapport aux événements cardiaques qui se produisent plus tard dans la journée.
Les INFARCTUS sont bien plus graves le matin
Les crises cardiaques sont beaucoup plus dangereuses le matin qu’à tout autre moment de la journée, car, en moyenne, elles entraînent des dommages dont le niveau de gravité sur le muscle cardiaque est de 20% plus élevé par rapport aux événements cardiaques qui se produisent plus tard dans la journée.